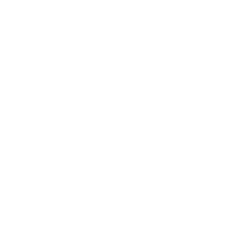« Ils veulent du sens, mais pas les responsabilités. »
« Ils ne respectent plus l’autorité. »
« Ils pensent qu’ils savent tout dès le jour 1. »
« Ils veulent un coach, pas un patron. »
« Ils sont trop sensibles, on ne peut plus rien leur dire. »
Ces phrases, je les entends beaucoup trop souvent. Elles surgissent dans les conversations informelles et flottent dans l’air ambiant, comme des vérités qu’on ne questionne plus. Ce sont des soupirs semi-amusés, parfois empreints d’exaspération. Mais derrière l’humour, il y a une certitude qui s’installe doucement … le problème vient des jeunes générations.
Et si cette certitude était justement… l’histoire qu’on se raconte pour éviter d’en explorer une autre ?
Le choc des générations… ou le confort des stéréotypes ?
On aime bien catégoriser. Génération X, Y, Z, alpha, silencieuse, boomer… c’est presque devenu un réflexe collectif.
C’est pratique : on colle une étiquette, on généralise un comportement, et on ne se pose pas trop de questions.
Mais dans ma pratique, ce que je constate surtout, c’est que ces histoires de « choc des générations » masquent souvent une réalité bien plus humaine, universelle et nuancée.
Et si ces frictions n’étaient pas liées à l’année de naissance de nos collègues…
Mais à notre inconfort devant la remise en question de nos repères de leadership, de pouvoir, de reconnaissance ou de contrôle ?
Même besoins, nouvelles expressions
À travers les âges, les besoins fondamentaux restent les mêmes : être vu·e, entendu·e, avoir un impact, sentir qu’on compte. C’est Maslow, c’est la base!
Mais les codes changent, les formes évoluent.
La quête de sens s’exprime autrement.
L’autorité ne se décrète plus, elle se construit.
Et l’engagement ne naît plus uniquement de la loyauté — il naît du sens, du lien et de la clarté.
Alors non, les jeunes générations ne sont pas en train de démolir le monde du travail.
Elles viennent remuer le statu quo, pas uniquement pour le provoquer, mais pour l’aider à évoluer.
Et ça fait du bien. Même quand ça dérange.
Une critique vieille comme le monde
Déjà dans l’Antiquité, Aristote soupirait :
« Les jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, méprisent l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. »
On pourrait le croiser dans une salle de réunion moderne sans que personne ne soit choqué.
Ce genre de propos, c’est un écho qui résonne depuis des millénaires. Alors peut-être qu’on ne devrait pas s’inquiéter de l’attitude des jeunes… mais s’interroger sur notre propre rapport à la différence, à l’évolution, à la perte de contrôle
Et maintenant, on fait quoi avec ça ?
On pourrait continuer à se raconter que le problème, c’est « eux ».
Ou on peut commencer à se demander :
Qu’est-ce que ça touche chez moi, quand je me sens déstabilisé·e ?
Qu’est-ce que j’ai besoin de déconstruire dans mes propres reflexes ?
Et si on posait les étiquettes, deux minutes, pour écouter ce qui cherche à émerger de nouveau ?
Et si on utilisait nos différences comme des leviers plutôt que des excuses ?
Si on arrêtait de pointer les différences d’âge comme des barrières…
Et qu’on les utilisait comme des ponts, pour mieux se comprendre, apprendre les uns des autres, et construire un avenir de travail plus humain, plus audacieux et plus vivant ?
On n’a pas besoin de générations parfaites.
On a besoin de générations qui se parlent, qui écoutent sans se défendre, qui osent se remettre en question sans s’effacer.
C’est dans la rencontre entre l’expérience qui rassure et l’élan qui bouscule que naissent les plus grandes transformations.
Et si on osait, pour vrai ?
Pas un tour de table forcé.
Pas un 5@7 « team building ».
Juste une vraie rencontre. Avec du silence s’il faut. Avec des désaccords aussi … mais du respect surtout.
Parce que derrière les générations, il y a des humains qui doutent, qui essaient, qui veulent contribuer à leur manière.
Alors, on commence quand ?